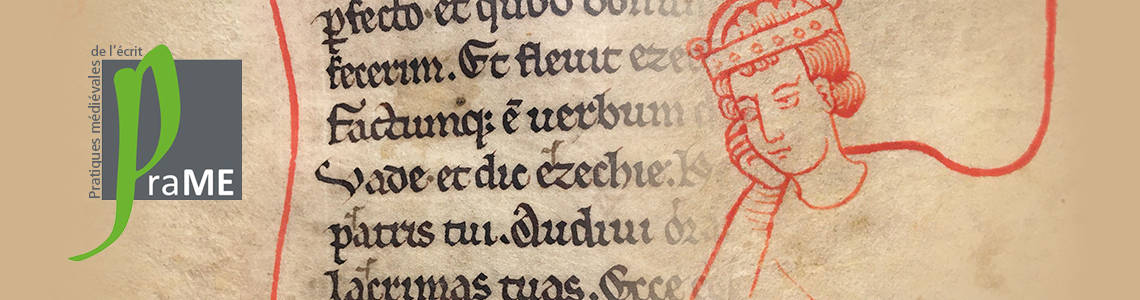Thèses en préparation
Le monde paroissial en Brabant et en Namurois. Structures et pratiques religieuses (XIIIe-XVIIe siècle)
Morgane Belin, sous la direction de Xavier Hermand (UNamur) et de Michel Dorban (Université catholique de Louvain)
Un laboratoire politique et institutionnel : les communautés urbaines entre Seine et Meuse, 1050-1250
Thierry Frippiat, sous la direction de Jean-François Nieus (FNRS/UNamur) et Paul Bertrand (Université catholique de Louvain)
Dans l'Europe urbaine du Moyen Âge central, l'espace compris entre Seine et Meuse se distingue précocement comme un foyer d'innovation politique et institutionnelle. Il voit tout particulièrement l’émergence de la commune urbaine, dont les historiens situent les premières attestations dans les années 1070. L’expression de « mouvement communal » désigne d’ordinaire ce phénomène s’étendant sur tout le XIIe siècle. Elle a vu le jour dans les années 1820, en même temps que l’érudition libérale s’emparait de cette problématique et imprégnait ainsi les premières pages d’une longue tradition historiographique. Labouré en tous sens par plusieurs générations d’historiens, le champ des « études communales » s’est néanmoins mué en friche depuis le milieu du siècle dernier. La dissonance des thèses proposées et certaines incohérences persistantes ont une part évidente dans la frilosité nourrie à l’égard de cette problématique, depuis les travaux d’A. Vermeesch (1966). Notre projet de recherche entend répondre à la nécessité criante d’un réexamen approfondi du dossier. Ce dernier s’impose d’autant plus que le dynamisme politique des villes, identifié comme une caractéristique majeure du « second âge féodal », reste paradoxalement le parent pauvre de la recherche récente autour du Moyen Âge central. En s’appuyant sur une relecture minutieuse et critique des sources, il s’agit de renouveler notre compréhension du phénomène communal, tel qu’il se déploie entre le domaine capétien et la Flandre.
Interaktions-, Integrations- und Transformationsprozesse im Spannungsfeld zwischen zentraler Steuerung und regionaler Eigendynamik (11. – Anfang 13. Jahrhundert)
Robin Moens, sous la direction de Jean-François Nieus (FNRS/UNamur)
Mes recherches, menées dans le cadre du projet DFG-FNRS InterLor (étudiant les procès d’INTERaction entre la papauté et les acteurs de l’ancienne LOthaRingie aux XIe-XIIIe siècle ; https://www.ma.histinst.rwth-aachen.de/cms/HISTINST-MA/Forschung/Projekte/~tqojt/INTERLOR-Lotharingien-und-das-Papsttum/, https://history.uni.lu/research-interlor/), portent sur les interactions entre le Saint Siège et les villes épiscopales de Liège et Metz du XIe au début du XIIIe siècle. Elles visent à saisir les dynamiques d’interaction, d’intégration croissante et de transformation dans les relations entre la curie romaine et cette région, marquée par une tradition de centralité dans l’histoire de l’Europe (postcarolingienne) et de puissance politique, aussi bien profane qu’ecclésiale. Leur centralité (relative) dans la chrétienté médiévale, comme aussi dans les vagues de « réforme » ecclésiastiques du Xe et XIe siècles, prédisposait ces deux diocèses à une interaction intensive avec le Saint-Siège, bien que leur intégration dans ce qu’on appelle couramment « l’Église impériale » est généralement considérée comme un facteur ralentissant dans ce processus. Une attention particulière est accordée aux mécanismes utilisés par la curie romaine dans leur recherche d’intégration majeure des deux villes cathédrales dans le réseau romain, comme aux motifs des institutions et personnes locales (en particulier les clercs des chapitres urbains et la bourgeoisie naissante), qui décident d’entamer une relation plus approfondie avec l’évêque de Rome et ses représentants.
Production et usages du livre dans les monastères bénédictins réformés à la fin du Moyen Âge : l’exemple de Saint-Jacques de Liège
Elisabeth Terlinden, sous la direction de Xavier Hermand (UNamur)